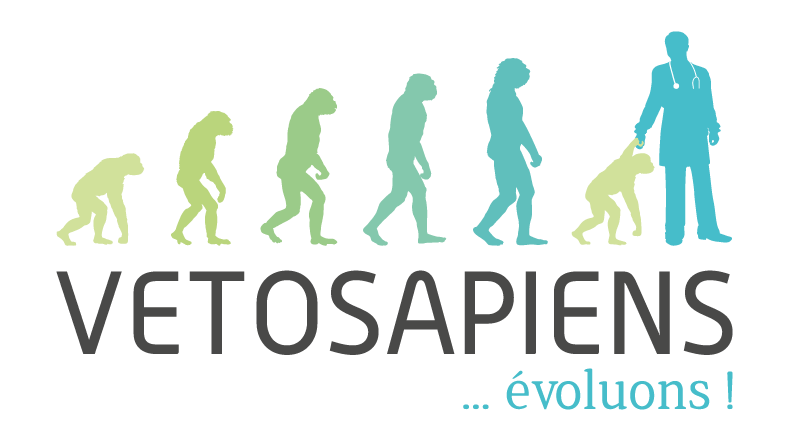Mis en ligne par : Anne Le Martret
Une synthèse
Traiter une envenimation par les chenilles processionnaires
Pathogénie:
La chenille processionnaire possède des soies urticantes qu’elle libère lorsqu’elle se sent en danger. Ces soies, en forme de harpon, peuvent se fixer sur l’épiderme, les yeux ou les voies respiratoires de quiconque s’approche de l’insecte. Il suffit alors de se gratter pour qu’elles se cassent et diffusent dans l’organisme une protéine toxique appelée thaumétopoéine. Les chiens sont majoritairement touchés car, intrigués, ils saisissent les chenilles lors de leur migration vers les lieux d'enfouissement.
Symptômes :
 - Oedème
- Oedème
- Erythème
- Ulcération
- Nécrose
- Ptyalisme
- Douleur
Conduite à tenir :
– Pour les intervenants: mettre des gants. Ne pas se frotter le visage pendant les manipulations.
– Faire rincer le chien, si possible avant de venir, pour enlever le maximum de poils urticants.
– A la prise en charge : Ne pas frotter. Tamponner avec du scotch ou une compresse bicarbonatée (solution à 1,4% diluée de moitié) la bouche et la peau. Rincer les yeux au sérum physiologique.
– Vérifier les voies aériennes. Intuber si besoin.
– Corticoides à dose anti-inflammatoire, base du traitement.
– Antibiotiques.
– Morphiniques voire Lidocaïne si douleur vive.
– Pose d’une sonde gastrique si anorexie.
– Parage des zones nécrosées si besoin, quelques jours plus tard.
Remarques :
– Il existe de rares cas de CIVD ou de choc les premiers jours.
– Une prise en charge très précoce par corticothérapie semble améliorer le pronostic.
– Les animaux compensent bien des pertes tissulaires importantes (langue).
Le cycle de la chenille processionnaire du pin
Cliquer ici pour voir le diaporama du cycle
Vie adulte : de mi-juin à août, les papillons sortent de terre pour une courte vie. Les femelles pondent 70 à 300 œufs sur une branche de pin.
Vie larvaire : Les chenilles éclosent un mois après. Elles tissent des nids pour passer l’hiver où elles restent ensemble à l’abri le jour. La nuit, elles sortent se nourrir. Elles deviennent urticantes aux derniers stades larvaires.
- -16°C : au-dessous de ce seuil, c’est toute la colonie qui meurt.
- 0°C : température nocturne minimale de l’air pour que les chenilles, qui ne se nourrissent que la nuit, sortent de leur nid.
- +9°C : température diurne minimale dans le nid pour que les chenilles puissent en sortir la nuit suivante. Ce seuil est appelé température d’activation.
- +32°C : température estivale au-dessus de laquelle les colonies peuvent être durement affectées.
Vie nymphale : de janvier à mars, elles quittent l’arbre en procession pour aller s’enfouir dans le sol à quelques centimètres de profondeur. Là a lieu la transformation en chrysalide. Elles restent en diapause jusqu’aux conditions idéales de sortie des papillons.
L’expansion de la chenille processionnaire
La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) est un insecte forestier en expansion progressive du sud vers le nord de la France sous l’effet du changement climatique. Elle colonise les milieux urbains à partir du compartiment forestier et soulève des problèmes phytosanitaires et de santé publique car les larves de ce papillon sont urticantes. Les chenilles consomment les aiguilles de différentes espèces de conifères (pins, cèdres, sapin de Douglas) et notamment d’espèces largement répandues telles que Pinus nigra, utilisées comme essence forestière ou comme arbre ornemental en milieu urbain et rural.

Le front d’invasion de cet insecte ravageur part du Finistère, passe par le sud de la région parisienne pour atteindre finalement le lac Léman. Le front avance en moyenne 5 kilomètres tous les ans, d’après les chercheurs de l’unité de recherche de Zoologie forestière qui suivent cette évolution. Au total, en quelque 20 ou 30 ans, la chenille s’est emparée d’environ 100 000 km2 de territoire français.
La chenille processionnaire gagne aussi des terres en hauteur. Ainsi, des zones élevées du Massif central, des Pyrénées ou des Alpes qui ne connaissaient pas l’insecte, sont désormais sous sa coupe. Les chercheurs calculent qu’elle gagne environ 5 mètres en altitude par an.
On a recensé huit foyers situés au nord du front d’invasion, dont six en Île-de-France. Elle a du profiter du transport d’arbres de grande taille contenant des chrysalides dans la motte.
La toxine contenue par les soies urticantes de la chenille processionnaire du pin met en danger le bétail, les animaux domestiques mais aussi les êtres humains. De plus, sa vorace activité défoliatrice réduit la croissance et fragilise les forêts de pins et cèdres.
Lutte contre la chenille processionnaire

Couper les branches, les brûler en se protégeant. Intervenir à l’automne car les chenilles jeunes sont moins urticantes.


Piéger les chenilles à leur descente de l’arbre

Poser des pièges à phéromones de juin et jusqu’à septembre octobre pour les papillons mâles.

Favoriser les prédateurs comme les mésanges en installant des nichoirs.
Les autres chenilles urticantes
La chenille processionnaire du chêne
Commune en Europe, les chenilles vivent en colonie et s’alimentent la nuit sur le feuillage. En été, les chenilles tissent un nid résistant composé de fils soyeux mêlés de déjections et d‘exuvies (mues desséchées de chenilles).

Ce nid, plaqué sur les troncs et les branches maîtresses, peut atteindre une taille importante en période de pullulation (un mètre de long et plus). Il contient les tissages individuels renfermant les chrysalides. Les adultes apparaissent trente à quarante jours plus tard.
Lors des contacts directs avec les nids et les chenilles, ce sont des milliers de poils urticants qui peuvent provoquer des troubles. A la fin de l’été, les nids vides peuvent tomber sur le sol. Ils restent urticants plusieurs mois.
Les chiens peuvent jouer avec les nids. Le traitement des urtications est le même que celui pour les processionnaires du pin.